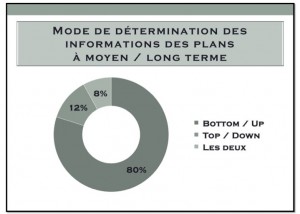A.
Voir Sigle.
Devenu la langue de référence dans la communication internationale, l’anglais s’est fortement développé dans le monde du travail du fait de la globalisation des échanges et de la production, mais aussi du poids économique, politique, culturel et symbolique des États-Unis. Outre la place hégémonique de l’anglais comme langue véhiculaire, les langues vernaculaires en font elles-mêmes un grand usage qui tend à de nombreux effets de contamination et d’hybridation d’ordre lexical, sémantique et syntaxique.
Entre management et marketing, l’entreprise est un lieu privilégié d’éclosion du néologisme d’origine anglo-saxonne. Il y vit bien car il répond à un certain nombre de critères d’utilisation : technique avec des mots intraduisibles (recherche, informatique), pratique car accélérant l’expression (abréviations ou raccourcis), grégaire comme le langage d’une tribu (les Apifious), logique puisque dérivé d’un concept nouveau (vente ou gestion notamment), snobisme pour marquer les limites du club (pouvoir et savoir)[1].
En France, le décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française s’emploie à lutter contre l’essor du « franglais » par l’élaboration d’une terminologie rendue obligatoire dans les services et les établissements publics de l’État. Régulièrement actualisé, le Vocabulaire de l’Économie et des Finances vise ainsi à faire rentrer dans l’usage les équivalents français de certains mots anglais, sans que le succès de la démarche ne soit systématiquement garanti : « chevalet de conférence » (paper board), « filoutage » (fishing), « franchisage » (franchising), « mentorat » (coaching), « mercatique » (marketing), « remue-méninges » (brainstorming)…
De l’utilisation intempestive du latin par les pédants et les imposteurs de tous poils dans les comédies de Molière au jeu sur les accents et les quiproquos linguistiques dans les vaudevilles de Feydeau, les langues étrangères s’invitent depuis fort longtemps dans les dialogues de théâtre où elles font bon ménage avec le comique de mots. Associant veines satirique et documentaire à des degrés divers, la scène contemporaine tournée vers l’entreprise est assez logiquement prompte à investir cette anglomanie dont les manifestations sont polymorphes, de l’emprunt lexical plus ou moins dispensable (« personal effectiveness », « personality fit », « curiosity », « pressure handling »[2]) à ses formes dérivées (« Si tu me mailes ton diagnostic je te forwarde les statistiques évolutives »[3]) en passant par la formule toute faite ou la phrase entière (« nous pouvons servir d’intermédiaire pour nos clients all over the world »[4], « BE OVER THE TARGET ! »[5], « Don’t confuse your audience with too much information, have a concept, make the client the hero of your narration »[6]).
En certaines occurrences, les indices de cette aliénation linguistique se font plus évidents encore, que l’écriture joue de l’effet d’accumulation (« on lui fixe un rendez-vous pendant le Case Meeting, pour lui parler combativité et Out Of Area Compatibility, et on lui propose un ou deux fit trainings »[7]) ou qu’elle en vienne à composer un sabir si composite qu’il devient difficile de distinguer l’hôte de l’intrus (« I am completely addicted au marché », « Tout est under control »[8]). La désarticulation du langage atteint son paroxysme dans la troisième (et longue) scène de Tops Dogs, pièce suisse qui évoque le quotidien d’un bureau de placement, la New Challenge Company, dévolu à la réinsertion professionnelle de cadres supérieurs au chômage :
Tresca. Augmentation des capacités.
Kœner. Total quality management.
Laurent. Business reengeneering.
Chariéras. Lean management.
Chabrier. Review culture.
Tresca. Direction de type émotionnel.
Bonnet. Optimisation des coûts.
Kœner. All-you-can-afford-method.
Allain. Cash-cow.
Bonnet. Cross-cultural-management.
Chabrier. Just-in-time-delivery.
Allain. Reframing.
Gimenez. Spill-over-effect[9].
Cette « bataille des mots »[10] réduit l’échange à la portion congrue. Délestée de toute fonction référentielle, le langage ne renvoie plus qu’à lui-même et circule indifféremment de bouche en bouche, selon un principe qui n’est pas sans rappeler le théâtre d’un Ionesco.
C’est précisément à la fin de La Cantatrice chauve que l’on pense lors du tableau que la pièce de Sylvain Levey, Dans la joie et la bonne humeur, consacre au licenciement de Marie, tandis que les trois cadres chargés de la basse besogne invoquent le CAC 40 à la façon d’un caquètement teinté de scatologie (« Caca cac quarante quarante cac cac »[11]) pour bientôt ensevelir leur interlocutrice sous les termes anglais :
Marie. Les mots sortaient de leur bouche.
Bruno. Carry trade.
Marie. En cascade.
Mathilde. Cash pooling.
Marie. En torrent.
Bruno. Delocalization. […]
Nicolas. Earnings before interest taxes and amortization.
Marie. Ils répétaient.
Mathilde. Taxes earnings interest and amortization before.
Marie. Dans le désordre.
Bruno. Amortization before interest taxes and earnings.
Mathilde. Before interest earnings and taxes amortization.
Bruno. Identification bank account number.
Marie. Des théories et des concepts.
Bruno. Identification bank account number.
Marie. Des idées et des croyances.
Mathilde. London international financial.
Bruno. And options exchange.
Mathilde. Je trouve que t’as bien l’accent.
Bruno. J’ai fait un stage même deux à Londres.
Marie. Je n’étais pour eux qu’un fantôme.
Nicolas. First in first out.
Marie. Un détail à régler[12].
Encore ne s’agit-il plus tant de « parler pour ne rien dire » que de camoufler la brutalité de ce que l’on est en train de faire. Dans la pièce de Ionesco, les personnages menaçaient de se jeter les uns sur les autres avant que tout ne revienne à la normale. Dans la pièce de Levey, tout le monde reste cordial tandis qu’une femme est licenciée.
À la place envahissante du lexique anglo-saxon dans la langue des cadres supérieurs, il convient enfin d’ajouter l’inscription physique de la présence américaine dans les pièces, soit que les entreprises fassent appel aux services de professionnels venant des États-Unis pour en importer les méthodes (Priscilla Robinson dans Aziou Liquid[13], Jack Donohue et Jenny Frankfurter dans Par-dessus bord[14]), soit qu’elles dépendent d’instances décisionnelles dont le siège se trouve aux États-Unis (comité exécutif dans À la renverse[15], fonds de pension dans Élisabeth ou l’Équité[16]).
Dans À la renverse, la mainmise américaine est entérinée dès le début de la pièce : comme nous en informe un long récit introductif, l’entreprise familiale que constituaient les Laboratoires du Docteur Sens est devenue, sous le nom de Bronzex, l’une des innombrables filiales d’un vaste conglomérat américain – Sideral – et cette tutelle apparaît très lisiblement sur scène par la coprésence des salariés de Bronzex et des membres de l’Executive Committee de la Sideral Corporation of Cincinnati (dont les paroles sont écrites en anglais, puis suivies de leur traduction française dans la version publiée à Actes Sud en 1986). Si les personnages de ces deux aires de jeu ne dialoguent jamais directement les uns avec les autres, l’entrelacs de leurs répliques respectives souligne leur interconnexion en même temps que les rapports de pouvoir et de dépendance qui lient la petite filiale française et la maison-mère américaine (« The problem with Aubertin he isn’t Sideralminded he thinks Bronzex first […] / As if Bronzex had any existence outside Sideral »[17]).
Cette mondialisation des échanges économiques et linguistiques est également au cœur d’Élisabeth ou l’Équité dont les tableaux alternent entre le siège social d’ATM à Paris, celui du fonds de pension Victoria Capital à New York et une usine d’ATM à Villeneuve-Saint-André. Sans oser l’enchevêtrement des lieux et des dialogues comme Vinaver, Reinhardt fait le choix similaire d’écrire en anglais tous les tableaux où intervient Peter Dollan, le président du fonds de pension (« Les tableaux 2, 7 et 20 ont été traduits par Kate Moran. Les versions originales en français se trouvent en fin de volume. »[18]). Le dernier de ces tableaux se déroule toutefois hors de son territoire, devant l’usine occupée de Villeneuve-Saint-André, où Dollan s’adresse aux délégués syndicaux qui ne maîtrisent pas l’anglais (« Il a dit Chinese. Chinese ça signifie Chinois. À Dollan. Chinese ? Chinese ? »[19]) et au directeur général d’ATM qui prend en charge la traduction très infidèle des deux parties (« Dubreuil. On s’en moque de ses états d’âme. Nous c’est le résultat final qui nous intéresse. / Couvelaire se tourne vers Dollan, un peu gêné. Eh bien, they think that you too, you are very friendly. They hope that it will be possible to find a solution. »[20]).
La rencontre physique d’un président de fonds de pension américain et d’un délégué syndical français constitue une première entorse au réalisme et permet d’exploiter un comique de situation empruntant à une très ancienne tradition théâtrale (que l’on songe à la scène où Dom Juan multiplie les va-et-vient entre Charlotte et Mathurine pour maintenir deux versions inconciliables de la même histoire). L’antagonisme social ici à l’œuvre paraît toutefois plus difficile à dénouer :
Dubreuil. Dites-lui texto qu’on se fout royalement qu’il perde du pognon avec nos grèves. Royalement. On attendra le temps qu’il faut. On le mettra à genoux. Allez-y. Traduisez.
Couvelaire hésite. Il se racle la gorge.
Dollan. What’s happening ? I’ve got a bad feeling that I’m missing something here. Your Trotskysts’ mood isn’t that great after all, is it.
Couvelaire. They are closing off again. Cramping up. I warned you. It is their nature they are very susceptible, very bipolar.
Dubreuil. Vous ne traduisez pas, là. Traduisez, on vous dit.
Couvelaire, à Dollan. They don’t care that you lose money, they are almost happy to hear this, it is a combat, they will go to the end, they are determined.
Dollan n’en revient pas. Il regarde Dubreuil avec étonnement.
Dubreuil, à Dollan. Yes. Royaly. Mais alors : royaly.
Dollan, à Couvelaire. They told you to tell me that ? Verbatim ?
Couvelaire. I even made it more toned down[21].
Si la reddition de l’une des deux parties semble la seule issue vraisemblable, la pièce privilégie pourtant la voie strictement théâtrale du deus – ou de la dea – ex machina, en l’occurrence une DRH équitable, anglophone de surcroît, soit l’Élisabeth du titre qui réintègre les négociations après en avoir été exclue et dont le retour en grâce permet d’enchanter la fable in extremis. Le dénouement a néanmoins la prudence de nous maintenir sur le seuil de la salle où auront lieu les échanges : to be continued…
[1] Christian David, « Petit lexique du franglais managérial », L’Expansion, 21 avril 1994.
[2] Falk Richter, Sous la glace, trad. Anne Monfort, dans Hôtel Palestine. Electronic City. Sous la glace. Le Système, Paris, L’Arche, 2008, p. 104.
[3] Alexandra Badea, Pulvérisés, Paris, L’Arche, 2012, p. 30.
[4] Urs Widmer, Top Dogs, trad. Daniel Benoin, Paris, L’Arche, 1999, p. 13.
[5] Christophe Tostain, Expansion du vide sous un ciel d’ardoises, Les Matelles, Éditions Espaces 34, coll. Espace Théâtre, 2013, p. 49.
[6] Falk Richter, Sous la glace, op. cit., p. 106.
[7] Ibid., p. 129.
[8] Alexandra Badea, Carnivores, inédit. Que l’on songe également aux attelages qu’affectionne Jean-Charles Massera dans les titres de ses œuvres : United Problems of Coût de la Main-d’Œuvre ou encore Another Way Now pourrait supprimer 2800 villages d’ici cinq ans.
[9] Urs Widmer, Top Dogs, op. cit., p. 26.
[10] Ibid., p. 25. « La bataille des mots » est le titre de la scène.
[11] Sylvain Levey, Dans la joie et la bonne humeur (ou Comment Bruno a cultivé un helicobacter pylori), dans Comme des mouches, pièces politiques, Paris, Éditions Théâtrales, 2011, p. 180. Ces accents régressifs sont également présents dans l’explosion verbale qui caractérise les échanges des Smith et des Martin à la fin de La Cantatrice chauve (« Quelle cascade de cacades… » répète-t-on alors en boucle).
[12] Ibid., p. 179-181.
[13] Olivier Brunhes, Koffi Kwahulé et François Prodromidès, Aziou Liquid. Rêves au travail, Paris, L’avant-scène Théâtre, n° 1226, 1er août 2007.
[14] Michel Vinaver, Par-dessus bord, dans Théâtre complet, tome 1, Arles, Actes Sud, 1986.
[15] Michel Vinaver, À la renverse, dans Théâtre complet, tome 2, Arles, Actes Sud, 1986.
[16] Éric Reinhardt, Élisabeth ou l’Équité, Paris, Éditions Stock, 2013.
[17] Michel Vinaver, À la renverse, op. cit., p. 131.
[18] Éric Reinhardt, Élisabeth ou l’Équité, op. cit., p. 9.
[19] Ibid., p. 128.
[20] Ibid., p. 125.
[21] Ibid., p. 129-30.