C.
Citations.
La Révolution française est une grande scène mythique de notre histoire contemporaine, avec son lot de légendes et de héros, de bons et de méchants, d’interprétations plus ou moins bien intentionnées véhiculées par notre imaginaire collectif. Pour contourner ces légendes, les comédiens ont travaillé à partir d’archives et de discours d’époque en privilégiant les idées par rapport au style et à l’étude des caractères[1].
Le travail de contournement voulu par Joël Pommerat semble interdire l’usage des citations : tout l’inverse du choix (au risque de l’artificialité) de Leslie Kaplan dont le récent roman offre au protagoniste, Mathias, le soin de délivrer ses souvenirs d’histoire de la Révolution au gré de son errance dans un Paris à la fois dissous dans la rumeur de mystérieuses émeutes et soumis à une réactivation mémorielle régulière. La citation, à cet égard, inscrit le discours du roman dans une pédagogie démonstrative qui ne néglige pas même une scène de salle de classe où se joue un exposé sur la Révolution, et assume le surgissement de l’imagerie.
Il connaissait toutes les phrases
Kaplan, Mathias et la Révolution
Il se réveilla deux minutes plus tard, devant lui une image, une tête coupée avec du foin dans la bouche.
Le contrôleur général Foulon, dit Mathias, quand on a montré sa tête à son gendre l’intendant Berthier.
Mathias vit en même temps les écriteaux pendus au cou de Berthier, il connaissait toutes les phrases, « Il a volé le roi et la France », « Il a dévoré la subsistance du peuple », « Il a été l’esclave des riches et le tyran des pauvres », « Il a bu le sang de la veuve et de l’orphelin ».
Leslie Kaplan, Mathias et la Révolution, Paris, POL, 2016, p. 14.
En revanche, chez Pommerat, faire dire à un député « nous ne sortirons que par la force des baïonnettes » ou à la reine « ils n’ont pas de pain ? Qu’ils mangent de la brioche ! »[2] reviendrait précisément à convoquer les mythes les plus rebattus. La reine de Ça ira ne se préoccupe donc pas de la faim du peuple. Il n’en demeure pas moins que le souvenir de ce cynisme verbal passe dans une forme de recyclage qui ne relève pas à proprement parler de la citation, mais plutôt de l’allusion par travestissement. Lorsque les femmes envahissent, dans la scène 20, l’Assemblée nationale (journée du 5 octobre 1789), la question alimentaire surgit à l’occasion d’un échange particulièrement mordant entre une femme qui se plaint de n’avoir plus, comme la plupart des « gens comme [elle] », « à manger que des fruits secs depuis des semaines », et le député Lacanaux, qui réplique : « C’est excellent pour la santé les fruits secs » (ÇI, 111-112).
Pommerat semble ici jouer des vertus de l’indirect, ou de ce que la philosophie de Port-Royal appelait « les idées accessoires » : l’échange renvoie thématiquement au souvenir facilement associé, dans l’esprit du spectateur, d’une anecdote vraiment topique, mais il faut apprécier l’humour propre à l’opération de neutralisation esthétique, de sortie de l’intensité pathétique propre aux situations et aux polarisations révolutionnaires. Prosaïsme du fruit sec et de son rapport à la tendance contemporaine au végétarisme versus luxe moelleux de la « brioche » : on est aux antipodes des choix d’une Sofia Coppola dans sa Marie-Antoinette (2006), où la brioche trouve une sorte d’avatar pop et fun (au prix d’une neutralisation cette fois politique du scandale) dans la débauche multicolore des montagnes de pâtisseries. L’un des enjeux du déplacement citationnel est bien alors, chez Pommerat, la réévaluation de la figure même de Marie-Antoinette : loin de la « reine scélérate » des pamphlets, loin, aussi, de la requalification de son inconscience politique en indolence dépressive de post-adolescente lost in Versailles chez Coppola, elle ne peut être mise en situation de prononcer la phrase scandaleuse. En revanche, ce que cette dernière manifeste de mépris social et politique est préservé dans le fait de prêter le Galgenhumor sur les fruits secs à un député de droite royaliste particulièrement violent.
Quant au député Boberlé, à qui il revient de tenir le rôle de Mirabeau le 23 juin 1789, c’est bien platement, en évitant soigneusement les inévitables baïonnettes, qu’il répond au chef du protocole :
Oui nous avons entendu les ordres qu’on a suggéré au roi de nous transmettre, mais vous venez de pénétrer ici monsieur dans l’enceinte sacrée de l’Assemblée nationale, instaurée par la volonté de toute la population française. Ici vous n’avez aucune fonction ni aucun droit pour vous exprimer, je vous demande donc de sortir (ÇI, 58).
À en croire ce que dit Guillaume Mazeau, l’historien associé à la création du spectacle, la Révolution aurait ainsi été « nettoyée de tout son fatras folklorique et des sédimentations mémorielles »[3]. Si les formules les plus célèbres – et les plus sujettes à caution historique – sont bannies de la pièce, les citations ne sont pas complètement absentes. Comme pour les noms de personnes (voir Noms), la fiction se nourrit beaucoup plus qu’annoncé des mots de la Révolution. Entre les deux extrêmes de l’invention absolue et de la citation fidèle, le texte de la pièce est surtout fait de réemplois plus ou moins éloignés des textes d’origine.
Le titre en est lui-même un exemple. Le « Ça ira » a été et reste l’un des chants révolutionnaires les plus connus. Encore en 1795, le très thermidorien Nouveau dictionnaire français contenant les expressions de nouvelle création du peuple français de Léonard Snetlage le place en tête de son entrée « Chanson patriotique », en le désignant d’ailleurs comme « danse nationale ». Son sens a varié au cours de la Révolution. Alors qu’il était d’abord un chant optimiste, annonçant que la Révolution suivrait son cours, il a dans un second temps été associé à l’idée de violence, avec l’expression « les aristocrates à la lanterne ». La pièce de Joël Pommerat donne à voir à la fois l’optimisme, incarné par le personnage du roi, et la montée de la violence. Plusieurs connotations – et plusieurs strates temporelles – se recouvrent ainsi avec cette citation éponyme.
Ça ira
Mercier, Le Nouveau Paris
Cette chanson, qui n’est pas un modèle de poésie, mais qui a donné un exemple frappant du pouvoir de la musique, présida aux travaux du Champ-de-Mars, et excita un transport universel dans tous les spectacles. Le sang ne coulait pas à cette époque ; l’amour pour la révolution était entier, l’énergie était pure, l’idée du meurtre ne s’y mêlait point ; on répétait ça ira d’un concert unanime. En vain le libertinage voulut profaner cette expression ; on apprécia à sa juste valeur une plaisanterie d’un mauvais goût, pour ne s’attacher qu’au véritable sens :
Ça ira !
La liberté s’établira ;
Malgré les tyrans tout réussira.
Le mot ça ira était d’ailleurs respectable par son origine ; nous l’avions emprunté au célèbre Franklin : c’était son expression favorite dans le plus fort de la révolution d’Amérique.
Louis Sébastien Mercier, Le Nouveau Paris, éd. Jean-Claude Bonnet, Paris, Mercure de France, [1798] 1994, p. 62-63.
La scène 17 permet de se faire une idée des textes que les comédiens ont travaillés pour préparer les improvisations et surtout de la manière dont ils sont passés dans le texte de Joël Pommerat. Trois éléments saillants de cette scène correspondent en effet à une même séance de l’Assemblée nationale, celle du 23 juillet 1789 : d’une part, l’annonce de la mort des intendants Foulon et Berthier, massacrés par la foule ; d’autre part, la mention d’une liste de proscription menaçant des députés conservateurs ; enfin, une phrase célèbre : « Ce sang était-il donc si pur ? » On peut donc comparer cette scène avec les comptes rendus publiés par les journaux dans les jours qui ont suivi la séance.
Alors que tout a été fait dans la séquence précédente pour que le mot « Bastille » ne soit pas utilisé, Foulon et Berthier sont désignés par leurs noms véritables. Certes, les spectateurs à qui ces deux noms disent encore quelque chose ne sont pas les plus nombreux. Certes, les faits rapportés sont attestés. Il n’empêche : ces noms font partie de la mythologie révolutionnaire. Les évoquer a souvent servi à accuser le peuple, et la Révolution avec elle. La pièce de Pommerat les tire de l’oubli et leur redonne la force de symboles.

« Mrs Delaunay Flexelles Berthier Foulon et les deux gardes du corps cherchent à se rendre aux Champs Elisées »
Estampe de 1789 – auteur non identifié
© Bibliothèque Nationale de France
Les orateurs évoquent Foulon et Berthier à trois reprises. La première fois, le président Boudin reçoit une dépêche dont il atténue l’horreur, disant de « Foulon » qu’il a été « exécuté de manière assez odieuse » et de « son beau-fils » qu’il a subi « de nombreuses mutilations » (ÇI, 84). La deuxième fois, un peu plus tard dans la même scène, le député Carray est plus précis : « Mesdames messieurs, ensuite ces gens ont arraché le cœur de la poitrine de monsieur Berthier et l’ont exhibé pareil à un trophée, en chantant et riant avec enthousiasme » (ÇI, 90-91). Plus loin, le même Carray reproche aux membres du comité de quartier de n’avoir pas dénoncé ces « exécutions » (ÇI, 104).
On peut comparer les mots choisis dans Ça ira avec ceux du Moniteur du 29 juillet 1789, souvent repris dans des textes postérieurs : « un monstre de férocité, un cannibale plonge sa main jusqu’au fond de ses entrailles palpitantes, lui arrache le cœur, et porte cet affreux trophée au comité, mué d’épouvante, et interdit de ce prodige de barbarie. »[4] Dans sa recherche de refroidissement de l’hyperbole révolutionnaire et de ses métaphores figées, Joël Pommerat supprime la plupart des images, mais il en garde une, celle du trophée, qui contribue à faire de la mort de Berthier un tableau exemplaire. On en viendrait presque à se demander si le cœur tiré de l’Anatomie des viscères qui figure sur la couverture du texte publié est celui de Berthier.
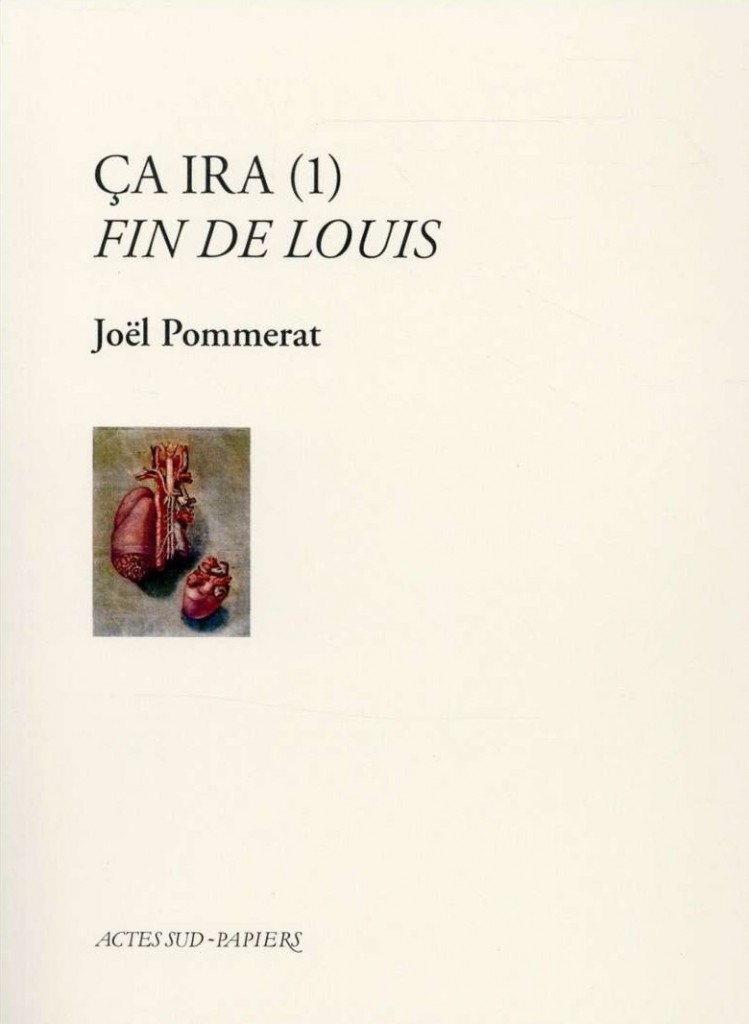
La couverture de Ça ira (1) Fin de Louis
Illustration extraite de Anatomie des viscères, disséquées, peintes et gravées par Arnaud Éloi Gautier d’Agory
© Actes Sud, 2016
Dans la séance du 23 juillet, le marquis Gouy d’Arcy, député de la noblesse, condamne lui aussi « la fureur où l’on vient de se porter contre deux individus » avant de faire état d’une menace qui concerne directement les députés les moins favorables à la Révolution : « Je n’entends pas ici vous effrayer ; mais, Messieurs, je dois vous dire ce que je sais ; il existe une liste de proscrits : soixante personnes y sont couchées, et plusieurs des honorables membres de cette assemblée sont du nombre. »[5] Dans Ça ira, le député Gigart dénonce de la même manière les « agissements [d’]un peuple criminel et sauvage » avant de sortir un papier de sa poche : « C’est une liste que ses auteurs ont nommée poétiquement “liste de personnalités idéologiquement douteuses à surveiller voire à éliminer” » (ÇI, 85-86). Le mot « liste » est cité, mis en scène même. Il le sera encore, avec une insistance renouvelée, dans la scène 19, marquée par une tension très forte dans l’affrontement entre deux figures (et deux conceptions) de la légitimité populaire, où Carray rend visite à ses anciens camarades de district : épisode nocturne, clandestin, mis en scène à partir de références assez aisément lisibles à une « grand’peur et misère » de régime policier qui charge la récurrence de la « liste » (au singulier, puis au pluriel) de connotations historiques et politiques nouvelles. Le mot « proscrits » est pour sa part paraphrasé dans une langue politique qui évoque plutôt la guerre froide que la Révolution française. Les éléments du texte d’origine sont donc déplacés, modifiés, mais repris de manière assez fidèle. La fiction est recomposition.
La scène comporte aussi une véritable citation dont la présence étonne. C’est le 23 juillet, au cours du débat suscité par l’annonce de la mort de Foulon et Berthier, que le député Barnave a prononcé l’une des phrases les plus célèbres de la Révolution : « ce sang était-il donc si pur ? » Or cette formule est reprise dans la pièce par la députée Lefranc : « Et d’ailleurs, je vous le demande aussi : ce sang-là était-il donc toujours si pur ?? » Cette phrase, dont il existe plusieurs variantes, a fait le malheur de Barnave : alors qu’il l’a prononcée sous le coup de l’irritation, dans le débat qui l’opposait à Laly-Tollendal, elle a été si souvent rappelée par ses adversaires qu’elle lui a valu une réputation de férocité dont il n’a jamais pu se défaire. Germaine de Staël résume ainsi cet épisode :
Barnave, jeune avocat du Dauphiné, de la plus rare distinction, était plus fait, par son talent, qu’aucun autre député, pour être orateur à la manière des Anglais. Il se perdit dans le parti des aristocrates par un mot irréfléchi. Après le 14 juillet, on s’indignait avec raison de la mort de trois victimes assassinées pendant l’émeute. Barnave, enivré du triomphe de cette journée, souffrait impatiemment les accusations dont le peuple entier semblait l’objet ; et il s’écria, en parlant de ceux qu’on avait massacrés : Leur sang était-il donc si pur ? Funeste parole, sans nul rapport avec son caractère vraiment honnête, délicat et même sensible ; mais sa destinée fut à jamais gâtée par ces expressions condamnables : tous les journaux, tous les discours du côté droit les imprimèrent sur son front, et l’on irrita sa fierté au point de lui rendre impossible de se repentir sans s’humilier[6].
Quand on regarde les premiers journaux qui rendent compte de la séance du 23 juillet, on est étonné par leur discrétion. Le Moniteur passe sous silence la phrase incriminée[7]. Le Mercure l’évoque au style indirect, sans préciser le nom de son auteur[8] ! Il semble bien qu’en 1789, faire cette citation était un choix partisan. On s’étonne de la trouver dans un texte aussi attaché à se défaire des symboles.
Faire prononcer cette phrase à la députée Lefranc en change également la portée. Ce ne sont plus des mots dictés par l’émotion, mais la confirmation de l’engagement radical qui caractérise ce personnage. La formule redevient exemplaire, comme lorsqu’elle était utilisée par les contre-révolutionnaires. Elle confirme aussi la nature du travail dramaturgique sur la matière historique des archives, visant à décevoir le jeu des identifications biographiques (voir Noms) puisque la même Lefranc, dans une scène 6 qui permet facilement une telle identification, non seulement reprend les formules de Sieyès sur « les députés du tiers état, représentants de la quasi totalité du peuple français » (ÇI, 33), mais porte la dernière sommation aux députés des ordres privilégiés de rejoindre le tiers et la proposition de l’appellation « Assemblée nationale », qui furent l’œuvre déterminante de Sieyès (ÇI, 34). Changeant ainsi de discours et d’identité référentielle possible, Lefranc inscrit son évolution dans la logique des « personnages-idées » voulus par Joël Pommerat et Marion Boudier.
Si les citations historiques sont bien repérables dans la scène 23, la part d’invention y reste. C’est ici, alors que les affrontements entre députés sont de plus en plus physiques, que le député Gigart se fait arracher sa chemise. Le mot « chemise » n’est pas dans le texte publié. En 2015, il ne faisait pas partie du spectacle. En 2016 – à Nanterre en tout cas –, il est prononcé plusieurs fois, notamment par Gigart qui dit quelque chose comme : « vous allez me rembourser la chemise que vous venez de me déchirer. » Il s’agit cette fois d’une citation improvisée d’un conflit d’aujourd’hui. Le 5 octobre 2015, le directeur des ressources humaines d’Air France s’est fait arracher sa chemise lors d’une manifestation. L’improvisation repose sur une culture politique commune née des actualités et de leur médiatisation. Mieux partagée que la connaissance historique, elle est aussi plus marquée à gauche et d’une certaine manière, plus consensuelle : le public rit des déboires de Gigart et sa sympathie va aux révolutionnaires radicaux, comme elle va aux grévistes d’Air France. Mais cette culture commune est éphémère : le fait divers syndical sera vite oublié. Le texte et ses arrières-textes, plus durables, présentent l’engagement politique sous un jour bien plus sombre.
Le sentiment m’entraîna peut-être trop loin
Barnave
Introduction à la Révolution française
Mais il est une circonstance sur laquelle il ne m’est pas permis de passer aussi légèrement ; c’est une opinion que j’ai prononcée après les assassinats de Foulon et de Berthier, et dans laquelle j’articulai ces mots : « Le sang qui vient de se répandre était-il donc si pur ! »
Je pense qu’il est impossible de justifier cette expression considérée comme ayant été prononcée dans une assemblée publique, et que, si elle eût été réfléchie, elle serait absolument inexcusable.
Mais voici, avec la même vérité, le mouvement qui se passa en moi, et comment elle me fut arrachée.
J’ai toujours regardé comme une des premières qualités d’un homme la faculté de conserver la tête froide au moment du péril, et j’ai même une sorte de mépris pour ceux qui s’abandonnent aux larmes quand il faut agir ; mais ce mépris, je l’avoue, se change en une profonde indignation quand je crois m’apercevoir qu’un certain étalage de sensibilité n’est qu’un jeu de théâtre.
Voici maintenant le fait :
Avant qu’on parlât, dans l’assemblée, de cet événement, Desmeunier me montra une lettre qui le lui annonçait. J’en fus fortement ému, et je l’assurai que je sentais, comme lui, la nécessité de mettre un terme à de tels désordres.
Un moment après, M. de Lally fit sa dénonciation. On aurait cru qu’il parlerait de Foulon et de Berthier, de l’état de Paris, de la nécessité de réprimer les meurtres. Non ; il parla de lui, de sa sensibilité, de son père ; il finit par proposer une proclamation.
Je me levai alors. J’avoue que mes muscles étaient crispés, et que le sentiment dont j’ai rendu compte, m’entraîna peut-être trop loin dans le sens contraire. Je dis que je m’affligeais de ces événements, mais que je ne pensais pas qu’il fallût, pour cela, renoncer à la révolution ; que toutes les révolutions entraînaient des malheurs, et qu’il fallait peut-être se féliciter que celle-ci n’eût à se reprocher qu’un petit nombre de victimes et le sang, etc. ; qu’au surplus, il convenait mieux à des législateurs de chercher des moyens réels d’arrêter ces maux, que de s’abandonner au gémissement, qu’il était douteux que la partie du peuple qui commettait des assassinats fût capable de sentir toutes les beautés d’une proclamation, et fût efficacement contenue par de si faibles moyens ; et que si l’on voulait prévenir les sanglantes calamités dont le royaume entier semblait menacé, il fallait se hâter d’armer les propriétaires contre les brigands, et donner, momentanément, une grande extension à la puissance des municipalités. Je rédigeai un projet de décret dans ce sens. Telle est, avec exactitude, cette circonstance dont la haine et l’esprit de parti se sont emparés avec tant de succès, que j’ai vu, depuis, beaucoup de gens qui, s’étant formé, sur ces deux mots, une idée complète de toute ma personne, s’étonnaient de ne trouver en moi ni la physionomie, ni le son de voix, ni les manières d’un homme féroce.
Antoine Barnave, Introduction à la Révolution française, dans Œuvres, Paris, Jules Chapelle et Guiller, 1843, p. 107-109.
Notes
[1] Joël Pommerat, « Entretien avec Marion Boudier, septembre 2015 », programme de salle, Théâtre Nanterre-Amandiers, 2016, p. 10.
[2] Sur cette expression, voir Véronique Campion-Vincent et Christine Shojaei Kawan, « Marie-Antoinette et son célèbre dire : deux scénographies et deux siècles de désordres, trois niveaux de communication et trois modes accusatoires », Annales historiques de la Révolution française [en ligne], 327|janvier-mars 2002, mis en ligne le 21 mars 2008.
[3] Guillaume Mazeau, dans « La fabrique du théâtre : entretien avec Guillaume Mazeau », propos recueillis par Nicolas Norrito, CQFD, n° 137, novembre 2015.
[4] Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 28, 29 juillet 1789, p. 235.
[5] Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 22, 23 juillet 1789, p. 192. Sur cette « liste de proscription », voir aussi le témoignage du monarchien Mounier, qui sera président de l’Assemblée au moment de l’arrivée des femmes de Paris le 5 octobre (Exposé sur la conduite de M. Mounier dans l’Assemblée nationale, 1789, p. 23).
[6] Germaine de Staël, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, Paris, Delaunay, 1818, vol. 1, p. 301.
[7] Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n° 23, 24 juillet 1789, p. 197 : « Il ne faut pas se laisser trop alarmer par les orages inséparables des mouvements d’une révolution. »
[8] Mercure de France, n° 31, 1er août 1789, « Journal politique de Bruxelles », p. 45 : « Un autre Député a pensé que l’Assemblée ne devait s’occuper que de la Constitution, non des dissensions de Paris, ni d’autres événements de cette espèce. Il a soutenu que les désordres et emportements du Peuple étaient des orages ordinaires pendant les révolutions ; la multitude pouvait avoir eu raison de se faire justice ; peut-être le sang versé n’était pas pur… Ces sentiments ayant excité un mouvement dans la Salle et dans les travées. »

