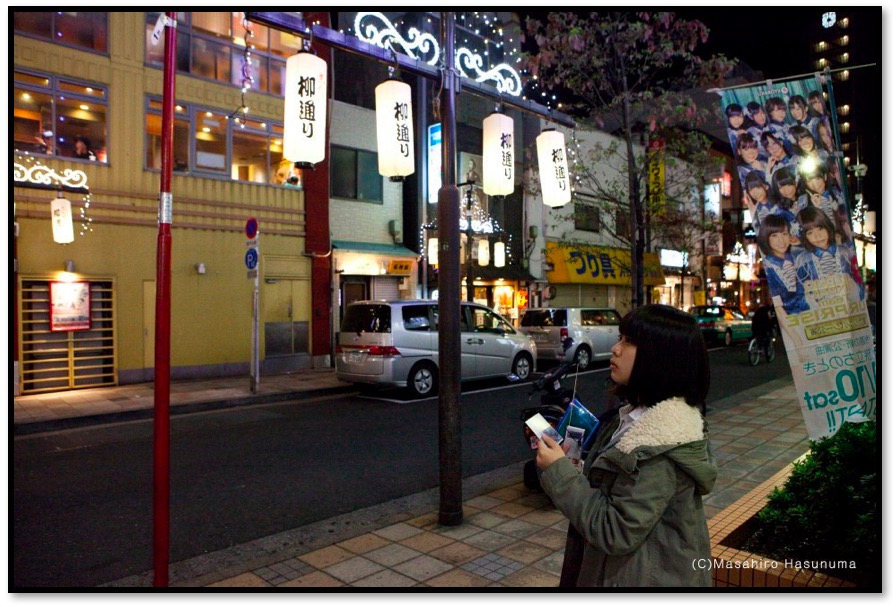Entretien réalisé par Bérénice Hamidi-Kim
Tokyo, octobre 2015
Curatrice et productrice, Chiaki Soma a fait ses études en France, à l’Université Lyon 2, puis est retournée au Japon où elle a fait beaucoup pour affirmer la nécessité du métier de programmateur, jusque là peu connu dans les institutions artistiques japonaises.
Elle a ainsi été la directrice de la programmation du festival de Tokyo de 2009-2013, et a donc programmé deux éditions du festival consacrées à l’après-Fukushima.
Elle est revenue avec nous sur cette expérience et sur les difficultés rencontrées
dans un pays où il n’est pas toujours évident que le théâtre s’empare de l’actualité et, surtout, assume une fonction critique vis-à-vis d’événements politiques et donc de décisions politiques.
Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le Festival de Tokyo ?
Ce festival est né en 2009. En amont, nous avions beaucoup réfléchi avec toute l’équipe organisatrice pour savoir quel serait le type de festival le plus adapté dans cette ville immense (13 millions d’habitants pour Tokyo même et 37 millions pour le centre métropolitain) déjà dotée de deux cents théâtres et salles de concert, où se trouvent aussi l’essentiel des galeries et des musées du Japon. Dans cet espace urbain totalement envahi par la logique capitaliste, fallait-il créer un événement de plus ? Je me suis dit qu’il fallait réinterpréter la notion de festival, de fête. Cela n’avait pas de sens de faire une programmation de plus des mêmes spectacles et événements artistiques. L’idée est donc venue de favoriser la rencontre avec des démarches artistiques que l’on n’avait pas la possibilité de rencontrer à Tokyo, et de donner à découvrir des lieux de la ville que l’on ne voit pas habituellement, de ne pas faire un gros événement qui nous extraie de notre quotidien, mais de le fragmenter pour qu’il s’insère justement dans la vie de tous les jours. L’enjeu était aussi de sortir des lieux théâtraux et du théâtre tel qu’il était produit et programmé jusque-là. Au Japon, où l’essentiel du théâtre repose sur des structures commerciales, l’idée était de montrer comment le théâtre peut être une force d’interrogation de la société, c’était quelque chose qui n’existait pas du tout. Il ne s’agissait pas de créer un nouvel événement culturel, mais de voir comment on pouvait expérimenter d’autres pouvoirs du théâtre. Nous avons aussi décidé que chaque édition serait liée à un thème et que la programmation répondrait à la question posée. Les six éditions biannuelles que j’ai programmées se sont intitulées : « Toward a new “real” », « Evolving “real” », « Disrobing theatre » (qui a suscité des réactions virulentes des gens de théâtre), « What can we say », « Beyond words » et « Travels in narratives ». Les trois dernières ont été programmées après la catastrophe.
Justement, pouvez-vous revenir sur ces éditions-là et plus généralement sur la manière dont les artistes avec lesquels vous avez travaillé ont « répondu » à la catastrophe ?
Le 11 mars a fait brutalement surgir la question : que peut l’art face à une crise ? À titre personnel, cet événement m’a mis face à une incapacité à imaginer, j’ai éprouvé au sens fort l’expression : « cela dépasse l’imagination ». Et puis, nous avons commencé à mesurer en quoi cet événement dépassait en effet l’imagination : la dévastation, les milliers de morts, l’accident de la centrale qui ne cessait de se répéter… J’ai fini par fermer mon bureau, pendant une dizaine de jours. Des artistes qui travaillaient au festival sont partis s’enfuir à l’étranger sans prévenir personne. Juste après la catastrophe, nous étions tous submergés par l’urgence de décisions à prendre qui pouvaient changer notre quotidien, notre vie : faut-il boire cette eau-là ? Faut-il partir ou rester ? D’ordinaire, on a bien moins conscience de l’importance de chaque choix. L’édition suivante était prévue six mois plus tard. Quand nous nous sommes remis au travail, il n’était évidemment plus possible de garder le thème initialement prévu. La question s’est imposée : « What can we say ». Le document de présentation dit assez bien l’esprit dans lequel nous étions :
quand un « grand récit » colossal a submergé notre normalité et que la réalité dépasse la fiction, […] il faut changer le thème et répondre à l’événement. Comment mettre des images et des mots sur « ça » ? Après la perte d’un nombre considérable de vies et de biens, après que des villes et des paysages ont été inondés et dévastés, comment concevoir et mettre en pratique un nouveau modèle de société et une nouvelle communauté ? Quel type de futur notre pouvoir humain nous permet-il de concevoir ?
Nous étions face à quelque chose qui nous privait de mots et l’idée était justement de trouver, au-delà de l’inexprimable et de l’indicible, comment arriver à dire quelque chose. Certaines compagnies étrangères qui étaient programmées ont annulé leur venue peu de temps après le 11 mars, par peur de la contamination. D’autres sont venus et ce qui a été formidable, c’est qu’ils ont joué le jeu, eux aussi, du changement de programmation. Par exemple, Romeo Castellucci avait prévu de travailler sur le texte d’un poète célèbre du nord du Japon, une région touchée par la catastrophe, « The Phenonemon called I ». Peut-être y avait-il déjà une dimension prémonitoire dans le choix de ce poème. Nous avons alors choisi comme lieu de représentation une île artificielle faite à partir des immondices de la ville de Tokyo, ironiquement appelée « the Dream Island » (Yume no shima). Parmi les déchets jetés dans cette île, se trouve le fameux bateau Daigo Furukyu-maru, qui, en 1954, avait essuyé un des essais nucléaires des îles Bikini et dont les marins ont été irradiés. Le bateau avait été jeté dans cette île, et il est toujours visible là-bas. C’est un endroit crucial dans la mémoire du nucléaire au Japon. Le spectacle de Castellucci, en extérieur, reposait sur la participation de cent figurants tournant autour de cent chaises vides blanches, chacun tenant en main un drapeau blanc. Un seul garçon avait le droit de s’asseoir sur une chaise. Un acteur professionnel, vêtu d’une cape blanche faite du même matériau que les drapeaux, une sorte de vinyle, venait le couvrir. Puis, l’ordre impeccable des cent chaises se désorganisait progressivement en chaos, les chaises se renversaient, comme poussées par une force invisible, sur une musique très sourde de chants grégoriens remixés. Puis les gens se regroupaient, agitaient les drapeaux. Bien sûr, pour nous qui avons vécu la catastrophe, impossible de voir autre chose que La Vague. Je crois que ce type de spectacle a été possible uniquement parce que c’était un étranger qui le faisait. Pour les Japonais, représenter cette catastrophe était impossible, chacun retenait cet acte de représenter. Ce spectacle est le premier que nous avons produit après la catastrophe. Le revoir après coup me donne l’impression d’un requiem, il manque sans doute de combativité et surtout de distance. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’il n’a pas fait l’unanimité… La réception est à resituer dans le contexte de l’époque, où travaillait une sorte de devoir de réserve. Castellucci ne percevait pas ce climat d’autocensure. Déjà, en amont de la création, quand le lieu a été choisi, il a fallu obtenir des autorisations auprès des autorités et, dans un premier temps, nous avons essuyé des refus. Ce qui me semblait dangereux dans la défiance des autorités ou des spectateurs, c’est qu’il n’émanait pas de victimes directes de la catastrophe, mais de personnes qui parlaient au nom des victimes pour dire que le spectacle était choquant pour elles. Ces personnes s’instituaient en représentants des victimes pour exprimer des résistances qui n’avaient en réalité rien à voir avec ce souci, louable en lui-même. Et c’est une situation qui, à mon avis, se prolonge aujourd’hui. D’une certaine manière, le devoir de réserve est même peut-être devenu encore plus fort, parce que le pays se tourne vers le futur de manière très volontariste, se fixe de grands objectifs pour redorer l’image du Japon aux yeux des Japonais et du reste du monde. Je pense par exemple aux prochains Jeux Olympiques. C’est une bonne chose bien sûr de rassembler la communauté nationale autour du sport, mais cela sert aussi à mettre sous le boisseau d’autres questions, et le passé…
Y a-t-il une réticence à ce qu’un étranger s’empare d’une question sensible qui a blessé la collectivité japonaise ?
Oui, j’ai souvent pu constater ce phénomène. J’ai reçu beaucoup de critiques, en tant que programmatrice, de la part de médias, de responsables politiques, et même de certains spectateurs japonais. Mais je pense que la logique du type : « c’est une catastrophe qui a blessé seulement la communauté japonaise et seule la communauté japonaise peut en parler » est à la fois dangereuse et fausse. Le théâtre a ce pouvoir de faire parler ceux qui ne peuvent pas ou plus parler – les morts, les absents, ceux qui n’ont pas la parole. Il est important de mettre en commun des questions, des témoignages. J’ai tout fait pour continuer à tenir cette ligne pour l’édition suivante, « Beyond words », cela semblait d’autant plus nécessaire à l’heure du « Ganbarô Nippon » (« Tiens bon, Japon ») – un mot d’ordre nouveau qui faisait un total consensus et créait une atmosphère presque totalitaire. Dans le même temps, on voyait apparaître de manière de plus en plus visible les fêlures striant le champ social après la catastrophe, y compris au sein de la communauté des victimes : entre les premières victimes du tsunami et les autres, entre les victimes qui avaient trouvé un sursaut et celles qui ne pouvaient pas, entre ceux qui avaient décidé de partir et ceux qui étaient restés, sans compter ceux qui voulaient partir, mais n’y parvenaient pas. La tendance était à la réduction à des oppositions grossières entre victimes et responsables (comme TEPCO), entre morts et vivants, entre humains et animaux, qui nous paraissaient très dangereuses. Il nous semblait que le théâtre devait proposer une autre lecture, une autre façon d’envisager cette réalité, plus fine, plus subtile. Nous sommes partis à la recherche de matériaux et de textes et on nous a appris qu’Elfriede Jelinek venait d’écrire Kein Licht – Epilog. Ce texte a fourni la matière du spectacle site-specific de Akira Takayama, Kein Licht II, un spectacle invitant chaque spectateur à une déambulation dans la ville et plus précisément dans le quartier de Shinbashi, où se trouve le bâtiment mère de l’entreprise TEPCO. On remettait à chaque spectateur un moniteur et douze cartes postales, représentant des images médiatiques de la catastrophe de Fukushima. Sur le verso de chacune se trouvaient une carte et des indications pour se rendre dans tel ou tel lieu. Une fois sur place, le spectateur comprenait la correspondance entre le lieu et la carte postale, et pouvait voir une installation retravaillant des images médiatiques célèbres de la catastrophe – un abri de réfugiés, un bac à sable inutilisé, un tas de terre recouvert d’une bâche bleue. Et à chaque « station », le moniteur diffusait des extraits différents du texte de Jelinek, traduits en japonais et lus par des lycéennes de la région de Fukushima. Le spectacle a été mieux reçu, peut-être parce qu’il s’agissait du spectacle d’un artiste japonais, même si le texte était celui d’une artiste étrangère.
Cette réception plus favorable ne tient pas aussi, au-delà de la nationalité de l’artiste, à la façon de donner forme à la catastrophe, de figurer l’événement ?
Oui, sans doute. C’est un peu par hasard que Castellucci s’est trouvé faire le spectacle d’ouverture avec cette création, et sans doute que le fait que le spectacle ait cette place dans la programmation a donné au spectacle et au discours qu’il tenait un poids symbolique particulier. Alors que ce choix s’explique par le fait que c’est un artiste que je présentais depuis plusieurs années et avec qui je travaillais en toute confiance… Jelinek, nous l’avons choisie précisément pour les modalités esthétiques de son approche de la catastrophe, qui nous semblait nécessaire dans un moment où nous étions submergés par l’approche journalistique. Il était impératif de faire entendre d’autres modalités de représentation de l’événement que la dramatisation et la « tragédisation », il me semblait crucial que le théâtre propose d’autres esthétiques possibles.
Pensez-vous que les différences esthétiques entre les spectacles s’expliquent davantage par la personnalité des artistes que par le fait qu’ils soient japonais ou étrangers ?
Les artistes japonais étaient évidemment plus touchés, donc six mois après, ils étaient encore trop perturbés, trop touchés : au Japon, nous ne savions pas vraiment quelle était la distance (spatiale et temporelle) entre l’événement et nous-mêmes. Dès lors, comment le représenter ? Comment en faire le récit ? Mais tout ce qu’on voyait sur les plateaux de théâtre était de toute façon contaminé par la catastrophe pour les spectateurs. Même s’il n’en était pas du tout question, le spectateur faisait le lien. Par exemple, quelques semaines après la catastrophe, Okada a joué Sonic Youth, et tout le monde a interprété le spectacle en fonction de l’événement alors que, franchement, le rapport n’est pas certain. En revanche, le spectacle suivant, Current Location, est une réaction très forte à la catastrophe, le langage théâtral d’Okada était nouveau et il a été changé par la catastrophe. Il a quitté l’hyperréalisme quotidien qui caractérisait jusque-là son œuvre.
Aujourd’hui, vous n’êtes plus directrice de la programmation du festival de Tokyo, et vos choix thématiques pour les trois dernières éditions n’ont pas été indifférents dans ce départ. Accepteriez-vous de nous en parler ?
Oui… La Ville de Tokyo, qui finance toujours actuellement le festival, est le premier actionnaire de TEPCO (Tokyo Electric Company), une entreprise aujourd’hui semi-privatisée, mais qui était à l’origine publique. Elle ne voulait donc pas que l’on parle de Fukushima de façon politique et encore moins critique à l’égard de l’entreprise. Et puis, au contraire de la France où les artistes ont en quelque sorte le devoir de porter une parole critique, ici c’est un tabou, ce qui est à mon avis le signe que nous ne sommes pas dans une démocratie mature. On dit que notre constitution garantit la liberté d’expression, mais la réalité est… différente. Je n’ai pas été licenciée pour cette raison directement. Ce qui est arrivé est assez révélateur de la manière dont sont prises les décisions politiques au Japon. Le gouvernement de la ville est très instable. L’équipe municipale s’est renouvelée, le maire a changé et le nouveau était moins intéressé par la culture, les fonctionnaires étaient plus réticents. Parallèlement, la ville a créé l’art council Tokyo en 2012, et certains de ses membres ont commencé à critiquer ma programmation. Durant mon congé maternité, d’une durée de deux mois, l’organisation du festival a été modifiée et, deux semaines après mon retour, j’ai appris mon licenciement. Comme j’étais employée par une association, la ville a fait comprendre à son président que s’il voulait conserver le festival, il fallait faire des compromis sur la programmation et changer l’organigramme. Au départ, on m’a proposé de prendre un congé maternité plus long, de trois ans, le temps que les choses se calment. Mais j’ai refusé, et je suis donc partie. La ville voulait garder le festival, qui avait une très bonne réputation à l’échelle internationale, mais en lui faisant perdre son côté « grain de sable ». Cette situation est aussi révélatrice de la situation des femmes dans le monde du travail au Japon, y compris dans le monde artistique… Derrière l’image de la petite communauté et de la famille, dès que tu t’affrontes aux décisions des pères, tu es très vite exclue. Récemment, j’ai été recontactée par la municipalité, on me demande d’organiser un énorme événement pour les Jeux Olympiques, même s’ils savent bien sûr que je déteste les gros événements nationalistes. C’est très intelligent, car si j’accepte d’être directrice de la programmation, ça donnera à la ville de Tokyo une image de démocrates. De fait, le climat politique a beaucoup changé depuis 2011, où un parti démocrate était au pouvoir. Un an et demi plus tard, les libéraux ont été élus à une grosse majorité. Ils sont très conservateurs et aussi très pro-militaristes, ils veulent restaurer l’image d’un Japon fort et conquérant. Par exemple, le gouvernement tente en ce moment de modifier l’article 9 de la constitution : « aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux ». Je pense que les étrangers sous-estiment la nature de la violence de ce gouvernement, qui est clairement lié à l’extrême-droite et aux Yakuzas. C’est bien pour cette raison que tous les ans, le Premier ministre visite le sanctuaire Yasukuni, alors que cela crée chaque fois un incident diplomatique avec la Chine et la Corée.
Comment le monde intellectuel et artistique réagit-il à ce climat ?
Nous sommes assez pessimistes. Avant que ces lois passent, il y a eu d’importantes manifestations, qui ont rassemblé des intellectuels et des artistes, mais quoi que l’on fasse, le gouvernement ne change rien. Nous avons de moins en moins le sentiment d’être dans une société démocratique. La difficulté tient aussi à la fracture qui existe aujourd’hui entre les artistes et les intellectuels d’une part, et le reste de la société civile. Depuis la fin de la guerre, nous avons toujours suivi les États-Unis, économiquement, mais aussi culturellement. Dans les années 1960-1970, nous avons donc aussi suivi le mouvement contestataire américain, et puis la gauche était plus forte qu’aujourd’hui, y compris chez les étudiants. Mais les décennies suivantes, la société est devenue folle économiquement, nous avons complètement cessé de nous intéresser à la politique, il y a presque une allergie. La plupart des moins de cinquante ans n’ont pas d’opinions politiques, ils sont dans une frénésie de consommation capitaliste. C’est lié aussi à l’éducation, les étudiants ne savent même pas tous que le Japon a colonisé la Corée, ils ne connaissent même pas le sens du mot colonisation… Autour de moi, aucune personne ne vote pour les conservateurs, mais je fais partie d’une petite communauté de gauche, la majorité de la population vote pour les conservateurs. Un autre problème tient à ce que les politiciens d’aujourd’hui sont presque tous des enfants d’anciens politiciens, ce qui perpétue une lignée pro-américaine très forte. Mais il y a des résistances, et parfois, la lutte est couronnée de succès. À Okinawa, par exemple, car l’État a forcé la préfecture à céder un terrain aux militaires américains. Les professeurs de l’université ont mené un combat avec la préfecture, qui a fini par céder et par refuser la demande du gouvernement, et Okinawa est en train de faire un procès au gouvernement central. Le préfet a entendu les voix de ses électeurs, même si le gouvernement tente toujours de passer en force. Ce succès tient au fait que les universitaires sont parvenus à se rallier l’opinion publique locale. Les artistes aussi peuvent susciter ces rapprochements, grâce aux formes qu’ils proposent. Le théâtre documentaire d’Akira Takayama est vraiment un très bon exemple : avant Kein Licht II, pour la première édition après le 11 mars, il avait créé The Referendum Project. Il s’est inspiré de la centrale nucléaire de Zwentendorf, une centrale autrichienne dont la mise en activité avait été suspendue à la suite d’un référendum, à la fin des années 1970. Dans un camion reconverti pour l’occasion, les spectateurs pouvaient visionner des entretiens vidéo de centaines de collégiens de Fukushima et de Tokyo, âgés de 12-13 ans. On leur posait à tous les mêmes questions sur leur vie quotidienne et sur leurs sentiments concernant la situation au Japon : qu’as-tu mangé au petit déjeuner ? Quel pays aimerais-tu visiter ? Penses-tu qu’il y aura une guerre dans le futur ? Que voudrais-tu dire au gouvernement ? Les spectateurs pouvaient voir autant d’entretiens qu’ils le souhaitaient, avant de « voter » pour un référendum fictif, en remplissant eux-mêmes un questionnaire posant les mêmes questions. C’était vraiment une manière de réagir à l’apathie du gouvernement, mais aussi d’inciter la société civile à l’action. Takayama a été un peu déçu par le manque d’intensité de la participation du public, resté plus spectateur que citoyen. Ensuite, le projet a beaucoup tourné à l’étranger : finalement, il a eu davantage la fonction de sensibiliser l’opinion publique internationale.
Pour citer ce document
Chiaki Soma, « Le théâtre face à la catastrophe et face au pouvoir. Les répliques artistiques et politiques du 3/11 au Japon », entretien réalisé par Bérénice Hamidi-Kim, thaêtre [en ligne], Chantier #4 : Climats du théâtre au temps des catastrophes. Penser et décentrer l’anthropo-scène, mis en ligne le 10 juillet 2019.
URL : https://www.thaetre.com/2019/06/02/le-theatre-face-a-la-catastrophe/