7. Qu’est-ce qu’on voit ? Et qu’est-ce que ça fait ?
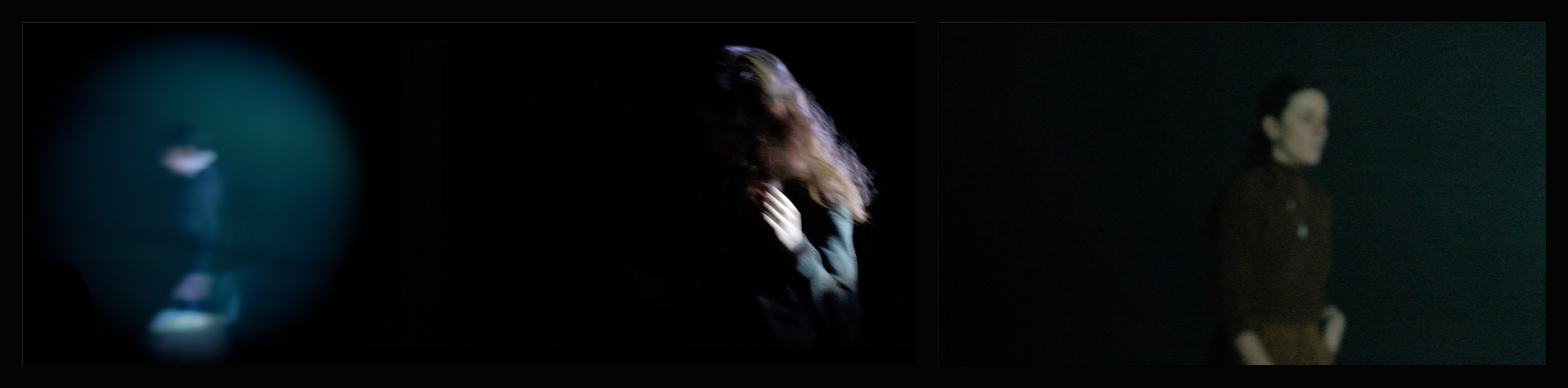
Shakespeare’s sisters
Francine Chevalier, Bibi von Sothen et Floriane Comméléran
Sortie de résidence à RAMDAM, UN CENTRE D’ART
© Manu Turlet
Ce que je vois et ce que j’entends dessine en moi (spectateur, spectatrice) un paysage. Il n’y a pas de causalité, il n’y a pas de logique, pas d’attendu, le sens est comme un champ de forces où ma pensée, mes sensations, mes émotions, traversées, permettent à une image de se déposer en moi, une image vivante, mobile, un espace ouvert et neuf. Qui m’appartient en propre. Un espace qu’on pourrait nommer liberté.
On voit un grand plateau presque vide, dans la brume, une vidéo projetée sur tout le mur du lointain.
On voit des silhouettes apparaître et disparaître dans le noir. De plus en plus familières, précises. Des objets, comme des installations fugitives. Des traversées, comme des haïkus visuels.
La présence et l’absence. L’irruption du possible au travers des dérapages infimes. Micro-expériences. Écriture en discontinuité sur la continuité du temps. Une exception après une autre. Des femmes. Sans chercher à ou sans pouvoir les inscrire dans un récit.
Des passages. Des traversées.
La séquence des diapositives.
La danse-combat d’Audrey.
Les parcours en ellipse de Francine.
Le sable qui s’écoule de son sac.
La petite lampe de Floriane. Ses bottes. Le bruit de ses pas. Le zip des bottes. Les clés qui tombent.
La lumière qui lâche.
Une chaussette, pas l’autre.
Audrey qui se baigne dans la lumière puis vient tout près de nous.
Son souffle, sa peine à reprendre sa respiration après le combat.
La jeune fille qui surgit et disparaît avec sa musique.
Le linge comme le monde.
La jeune fille assise dans l’ombre.
La danse. Le son. Trop.
La vieille femme assise sur sa chaise.
Devant le pas de sa porte.
Mary, assise très droite, dit trois fois : « I love you, I love you, I love you. »
La chaise seule. La chaise comme une micro-expérience de l’attente.
La micro-expérience de la solitude.
La micro-expérience de la peur.
La micro-expérience de la fuite.
Rester. Prendre place.
Elles sont là. Elles étaient là.
Une autre voix.
L’ombre d’un regret.
Un amour fou.
L’envie d’embrasser, de serrer dans les bras, de caresser, de pleurer.
La naissance d’un rire.
La sensation de la joie.
La neige.
La comédienne qui s’avance.
Le poème.
Notre présence.
Shakespeare’s sisters
Sortie de résidence à RAMDAM, UN CENTRE D’ART
© Manu Turlet
Chère Anaïs
Je partage ici le retour
que m’a fait Marion Chénetier-Alev,
venue assister à notre dernière sortie de résidence.
Pour saisir un peu de ce que notre intention avait rencontré
chez elle, comme spectatrice, je lui avais demandé
de m’écrire de quoi elle se souvenait,
et ce que ça lui avait fait.
Chère Anaïs,
Votre spectacle m’a laissée pantoise,
je vous envoie ces quelques lignes.
Bien à vous, bon week-end, à bientôt.
Spectacle complètement inattendu, qui fait la part belle au sonore. Il commence dans une obscurité enfumée. Rien sur scène, pendant longtemps, tandis qu’une voix, timbre attachant, qui retient l’attention, diction claire, débit rapide et net, entame la « litanie des femmes », la minuterie mentale permanente : le décompte quotidien, qui fait alterner le plus prosaïque et le plus grave, le domestique et le professionnel, l’intime et le social, la surface et la profondeur, le visible et l’invisible, dans une succession vertigineuse où s’engouffrent les heures et les jours, la vie.
C’est comme un jeu aussi, où chacune repère les pensées communes, les hiatus si connus, les grincements sous-jacents. Le dit suffit à faire parler, en creux, en silence, muettement, ce qui est toujours tu. La succession mécanique traduit puissamment le cri intérieur informulable, les doutes, les questions obsédantes. Le détail (se faire les ongles, penser à acheter tel produit) renvoie aux grandes lignes structurantes d’une existence, et à leur fragilité.
Sur la scène, montrer le moins pour faire exister le plus. Quatre femmes (il me semble), trois jeunes et une plus âgée, abîmée, qui marche difficilement, traversent le plateau en diagonale, de façon a-rythmée et sans aucune dimension illustrative par rapport au texte, esquissant telle action (enlever ses chaussures) peu expressive, ou pas. C’est minimaliste. Cela procure une sensation de libération intense. Délivrance de la vue. Jouissance de ce plateau embrumé où rien n’arrive et où donc on peut tout projeter. C’est bienfaisant.
Justesse de la construction rythmique : dans la litanie continue se fait entendre soudain une seconde voix, peut-être une troisième mais je n’en suis pas sûre, c’est plutôt l’indistinction qui est intéressante et travaillée ici, ce qui importe sont ces subtiles modifications du continuum sonore.
Or sur le plateau émergent tout à coup, de la même pénombre confuse, à main droite, les corps de ces deux voix qu’on entendait jusqu’à présent. Les deux jeunes femmes sont de profil, devant un pupitre, et poursuivent leur énumération. Je ne sais plus si elles disparaissent à nouveau. Et je ne sais pas non plus si elles étaient là depuis le début, et si c’est leur voix en direct que nous entendions ou pas. Il semble que oui.
Autre rupture rythmique et sonore bienvenue : une des jeunes femmes vient sur scène danser sur une musique très scandée, elle chante et son corps explose dans la danse, comme une résolution soudaine de ce qui a été scéniquement retenu jusqu’ici – puis la scène replonge dans le rien. La vieille femme (old woman des contes, de toujours, concierge, sorcière de Shakespeare, mère, son passé avec elle resté dans l’ombre, vieille femme du théâtre et des imaginaires) réapparaît.
En parallèle, sur un écran vidéo qui couvre le fond défilent des images étranges, elles aussi décorrélées, du moins en apparence, de ce qui se dit : paysages vidés d’humains, des vagues ?, routes se perdant, silhouettes. Image brouillée elle aussi, comme une invitation à se perdre, ou ce qui échappe à la saisie.
Plus généralement, le parti pris d’ensemble d’opacité – excepté au plan sonore qui contraste par sa clarté – opacité des personnages, du plateau, des images vidéo, est vécu comme une délivrance de l’imaginaire, de l’assignation permanente à plus de visibilité-compréhension-traitement-opinion immédiats de tout / sur tout. Salutaire refuge de l’indistinction, des éléments non séparés, d’une forme de magma d’où se détache, parfois, fugitivement, quelque traversée.
La radicalité assumée de cette anti-spectacularité m’enchante, de cette désarticulation des éléments sonores, visuels, imaginaires, plastiques, de l’autonomie comme nonchalante des uns et des autres. Très reposante pénombre bruissante, comme un bain enveloppant – mais qui aiguise aussi les sens.
L’effet en retour de ces existences minutées et perdues est à la fois trouble, triste, questionnant. Il y a aussi là une façon de nous confronter au temps s’écoulant, une juxtaposition subtile de nos voix intérieures, et des voix présentes / absentes, intérieures / extérieures des comédiennes ; une façon de faire entendre la « voix du dessous » réelle, la vraie, sous les bruits et les discours de toute nature qui la recouvrent en permanence ; de donner une forme précaire au destin des minutes qui nous dissolvent.
Marion Chénetier-Alev
Shakespeare’s sisters
Sortie de résidence à RAMDAM, UN CENTRE D’ART
© Manu Turlet








