Entretien réalisé par Floriane Toussaint
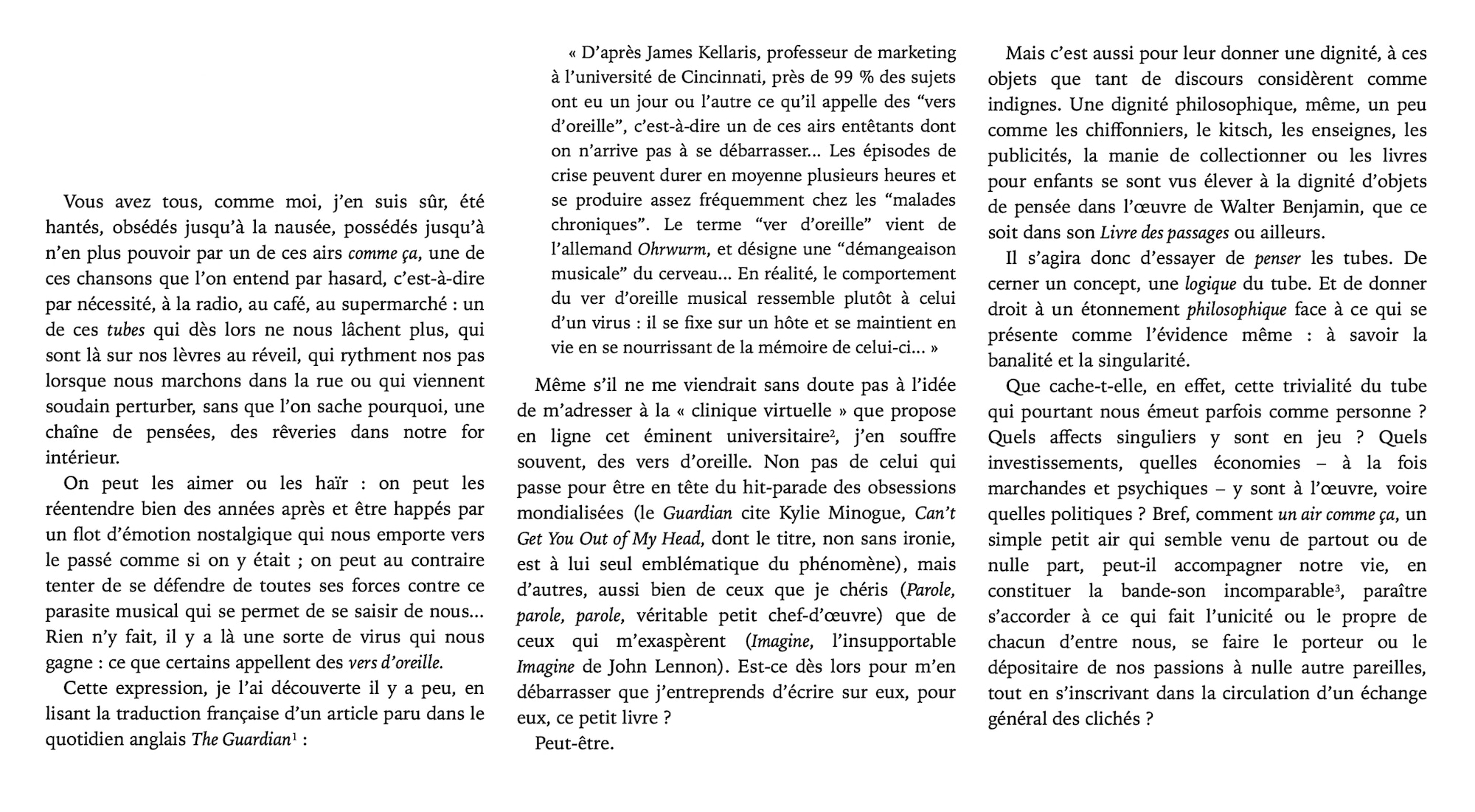
Peter Szendy, Tubes. La philosophie dans le jukebox
« Vers d’oreille (la bande-son de la vie) », p. 7-9
Minuit, 2008
Nous avons souhaité inaugurer ce numéro de la revue thaêtre par un entretien avec vous, car la lecture de votre essai Tubes. La philosophie dans le jukebox[1], a été déterminante dans la genèse de notre réflexion. Pour commencer, pourriez-vous nous proposer une définition de la notion de « tube » ? Quelles sont les caractéristiques qui permettent selon vous de définir un morceau de musique comme un tube, par rapport à un autre morceau ?
Chaque fois qu’on m’a posé la question, j’ai essayé de résister à la tentation de définir le tube en tant que forme musicale identifiable au moyen de caractéristiques objectives qu’il suffirait d’énumérer. Et si je résiste encore, malgré tous les critères qui se bousculent immédiatement dans mon esprit (la brièveté relative, la répétition, la simplicité mélodique qui se prête à la mémorisation…), c’est parce que, au fond, j’aimerais penser que tout pourrait devenir un tube. Ou du moins que tout fragment ou bribe de musique pourrait se charger d’une force obsédante telle que son retour incessant et irrésistible devient une véritable hantise. Une « idée fixe », comme disait Berlioz à propos de la phrase mélodique dont il a orchestré l’insistante récurrence dans sa Symphonie fantastique. Je dirais volontiers que cette mélodie berliozienne est un tube, même si, contrairement à ce qui se passe dans ce qu’on appelle en général des tubes, elle ne cesse de se métamorphoser. Disons qu’elle a du moins la fonction d’un tube, elle qui est faite pour obnubiler et assaillir l’auditeur, de même qu’elle harcèle le héros imaginaire mis en scène dans la symphonie.
En découvrant un petit récit de Mark Twain, je me suis même dit qu’il pourrait y avoir des tubes autres que musicaux. Ce récit, lorsqu’il fut publié d’abord en 1876 dans le magazine The Atlantic Monthly, avait pour titre : « Un cauchemar littéraire » (A Literary Nightmare[2]). Et ce qu’il relate, c’est la manière dont quelques vers parfaitement idiots composant une stupide petite forme poétique prennent possession du narrateur, lui imposent leur cadence lancinante, le submergent, le tourmentent jusqu’à lui rendre la vie impossible. Ce que le pauvre narrateur décrit, c’est ce qui se passe si souvent lorsqu’un tube décide de se loger en moi :
Je renonçai à mon travail et pris le parti de faire un tour en ville ; mais à peine sur le trottoir, je m’aperçus que mes pieds marquaient la cadence de ces maudits vers. N’y tenant plus, je ralentis le pas ; mais rien n’y fit : le rythme de ces vers s’accommoda de ma nouvelle allure et continua à me poursuivre[3].
Le tube, ce serait donc ce « torturant refrain » (torturing jingle) dont parle le narrateur de la nouvelle de Mark Twain. Mais il est vrai qu’une telle définition de la notion de tube, tout en cherchant à l’indéfinir (à la rendre accueillante à toute sorte de formes et même de médiums, de la musique à la versification en passant par le langage courant), finit par la restreindre à un effet, à savoir l’obsession ou la hantise. Est-ce légitime ? Ou doit-on libérer le tube de cet effet supposé qu’on lui attribue volontiers, pour considérer au contraire son contenu, sa teneur ?
C’est pour faire droit à cette autre approche possible que j’ai voulu, dans Tubes, prêter l’oreille à ce que les tubes eux-mêmes disent des tubes. Et ce que disent nombre d’entre eux, c’est que leur sujet par excellence est la banalité dans ce qu’elle peut avoir d’émouvant ou de touchant, de bouleversant, même ; les paroles de ce méta-tube, de ce tube sur les tubes qu’est « Le Tube » de Boris Vian (écrit pour Henri Salvador en 1957, un an avant que le mot « tube » n’apparaisse dans En avant la zizique… et par ici les gros sous[4]) le disent mieux que toute explication : « V’là les accessoires pour faire un succès. / Une rue, un trottoir, une môme bien roulée. / Un gars, chandail noir et cheveux collés. / Rengaine qui traîne, ni triste ni gaie… »
Henri Salvador, « Le Tube », 1957
Paroles et musique de Boris Vian
Live in Paris, 1958
Une saisissante banalité, en somme, si l’on peut penser un tel paradoxe (dans le même sens, je parlais dans Tubes du « bouleversant ennui »[5] que dégagent nombre de chansons à succès). Voilà pour ce que disent (ou chantent) nombre de tubes au sujet de leur être-tube même, lorsqu’ils se livrent explicitement ou implicitement à une analyse tubologique d’eux-mêmes.
Mais, au-delà de l’effet des tubes et de leur teneur thématique, il y a aussi ce qu’ils font : à savoir (c’est une de leurs caractéristiques, sinon nécessaire, du moins récurrente) mettre en scène, théâtraliser leur répétition comme si elle constituait leur destin, leur aventure la plus propre. Et souvent, cette dramaturgie de la récurrence se joue dans le passage du refrain au couplet, comme j’ai tenté de le montrer pour ce cas paradigmatique (cet autre méta-tube ou hyper-tube, si l’on veut) qu’est « Parole parole », chanté par Mina en 1972, avec l’acteur Alberto Lupo, puis repris en version française par Dalida et Alain Delon. Le refrain de cette chanson est une célébration de sa propre envolée, il chante son propre devenir-refrain, c’est-à-dire sa vocation à faire oublier tout ce qui aura été raconté dans les couplets (« des mots, rien que des mots ») au profit d’un pur désir de ritournelle, au profit du retour lancinant d’une musicalité pure.
Aucune de ces trois approches – l’effet des tubes, leur teneur, leur dramaturgie interne – ne suffit à véritablement définir ce qu’est un tube. Mais elles convergent certainement pour circonscrire un peu les contours de cet objet fantomatique et fantasmatique qui ne cesse d’exercer sa fascination dans et depuis la hantise même qu’il produit.
Mina & Alberto Lupo, « Parole parole », 1972 – extrait
Album de Mina, Cinquemilaquarantatre, 1972
Version remasterisée
Nous avons placé au cœur de notre réflexion la notion d’irruption, car dans plusieurs spectacles récents que nous avons vus, un morceau connu et immédiatement reconnaissable retentissait de manière imprévisible. Dans votre essai, vous écrivez : « C’est lorsqu’on s’y attend le moins qu’on en est saisi, au plus profond. »[6] Est-ce que les tubes sont définis par leur « force de surgissement » ? Leur capacité à s’imposer à l’improviste – que ce soit au quotidien, ou dans un spectacle ? Comment expliquer cette capacité des tubes à nous saisir et, selon vous, par où nous saisissent-ils ?
Je ne dirais pas, là non plus, que les tubes sont définis par cette capacité qui est la leur de surgir à l’improviste, en bouleversant tout horizon d’attente. Au contraire, peut-être : leur force irruptive de surgissement vient en excès de leur être, en excès de la répétition attendue et programmée qui fait précisément d’eux les tubes qu’ils sont. Cette force caractérise plutôt ce qu’il faut bien appeler leur vie ou survie dans l’inconscient, c’est-à-dire dans une mémoire qui n’appartient pas strictement au sujet porteur du tube, à celle ou celui qui le véhicule sans le savoir. Il s’agit plutôt d’une mémoire dont ledit sujet est dépossédé, qu’il ne maîtrise pas.
Pour le dire autrement, on pourrait penser que l’irruptivité du tube n’appartient pas à l’espace du même (à la répétition qui le caractérise et aux infinies reprises auxquelles il donne lieu consciemment) mais qu’elle vient de l’autre, qu’elle arrive depuis l’altérité d’un espace autre. Theodor Reik, auquel je consacre nombre de pages dans Tubes, a décrit et analysé en termes psychanalytiques la manière dont les tubes ressurgissent par surprise depuis le refoulement où la censure du moi peut les confiner : ils sont alors généralement, du moins dans l’explication qu’en donne le psychanalyste, porteurs d’un message que le sujet préférerait ne pas entendre, d’un désir un peu inavouable. C’est la raison pour laquelle ils se présentent souvent sous la forme d’une bribe mélodique non identifiée de prime abord : qu’est-ce que cette mélodie qui m’obsède (cette haunting melody, comme dit Reik[7]), d’où vient-elle, elle qui est si familière mais que je ne parviens pas à identifier ? Ce qu’il y a donc de saisissant dans l’irruption du tube, dirais-je, c’est précisément l’altérité insoupçonnée du même (l’inquiétante étrangeté, si l’on veut) dont il s’avère soudain le vecteur.
Le bref récit de Mark Twain que je citais suggère une autre manière encore de penser que le tube, lorsqu’il se saisit d’une psyché, d’une âme, le fait en arrivant depuis l’espace de l’autre. Comme je le disais, il s’agit dans ce récit d’un tube purement langagier, c’est-à-dire de quelques vers stupides dont les rimes idiotes obsèdent le narrateur. Et celui-ci ne parvient à s’en débarrasser qu’en le refilant à quelqu’un d’autre, à un ami :
À ce moment, il me sembla qu’un lourd fardeau venait de dégringoler de mes épaules ; mon cerveau se sentit débarrassé de ce torturant refrain et j’éprouvai une profonde sensation de repos et de bien-être. Mon cœur était si léger que je me pris à chanter pendant une demi-heure, tandis que nous rentrions doucement chez nous. Ma langue déliée se mit à parler sans discontinuer pendant une grande heure ; les paroles coulaient de ma bouche comme l’eau d’une fontaine. Au moment de prendre congé de mon ami, je lui serrai la main et lui dis : « Quelle royale promenade nous venons de faire ! Mais je constate que depuis deux heures vous ne m’avez pas adressé la parole. Voyons, parlez, à votre tour, racontez-moi quelque chose ! »[8]
Mais le pauvre ami jette alors sur le narrateur « un regard lugubre », pousse « un profond soupir » et articule « machinalement » la petite comptine versifiée qui a pris possession de lui en se détachant de son porteur initial. Pour le libérer à son tour, le narrateur décidera finalement de conduire son ami contaminé « à l’Université la plus proche, et là, il put décharger le pénible fardeau de ses rimes obsédantes dans les oreilles des pauvres étudiants »[9].
Ce récit qui se veut presque burlesque dit toutefois, si on le prend au sérieux, quelque chose de la nature essentiellement circulatoire du tube. C’est presque comme si la souffrance qu’il provoque en restant prisonnier d’une psyché donnée devenait la sienne propre, celle de ce tube qu’il est, contrarié dans sa vocation à passer de sujet en sujet, sans relâche.
La force de surgissement des tubes est étroitement liée au fait qu’on les entend par hasard et partout : « à la radio, au café, au supermarché »[10] (nous pourrions ajouter sur les serveurs téléphoniques, pour prendre en compte des tubes de musique classique). Cette diffusion constante des tubes, liée aussi à leur valeur marchande, contribue-t-elle paradoxalement à les disqualifier ? à diminuer leur valeur artistique ?
Votre question, à bien y réfléchir, est beaucoup plus complexe qu’elle n’y paraît. J’étais tenté d’y répondre spontanément en disant tout simplement que, si la valeur est proportionnelle à la rareté, alors oui, le tube, par sa nature même de tube, ne peut que se présenter d’emblée comme dévalué. Sur le plan de la valorisation esthétique, s’entend, puisque, sur le plan strictement marchand, c’est exactement le contraire. Le tube, c’est le jackpot, c’est le profit inespéré sur le marché des marchandises musicales.
Mais quand le tube s’insère dans la texture ou la trame d’une œuvre – comme c’est le cas des spectacles de théâtre auxquels vous faites allusion –, la question se pose tout autrement. Le tube produit alors une indéniable valeur ajoutée, une plus-value qui tient précisément, d’une part, à sa popularité, à son hyperdiffusion, mais aussi, d’autre part et paradoxalement, à son peu de valeur esthétique. Ce qui est alors le comble de la valeur, c’est la valorisation du sans-valeur.
À l’orée de votre essai, alors que la musique a toujours été au cœur de vos travaux, vous signalez la singularité de votre démarche ici et déclarez vouloir conférer une « dignité philosophique »[11] à des objets qui relèvent du champ de la banalité, du trivial. Vous dites vouloir penser les tubes, cerner leur logique, faire preuve face à eux d’un étonnement philosophique. Ce hiatus entre culture mineure et culture majeure, culture légitime et culture populaire, se retrouve dans la démarche des artistes qui font usage de tubes dans leurs spectacles. Des tubes des Clash ou de Billy Joel ont par exemple pu faire irruption dans des mises en scène du Misanthrope, d’Ivo van Hove et de Jean-François Sivadier[12]. Dans le champ intellectuel comme dans le champ artistique, s’agit-il selon vous de requalifier les tubes ? de jouer sur un effet de surprise en convoquant les tubes là où on ne les attend pas ? de miser aussi sur une certaine forme de séduction qu’ils exercent, en tant qu’objets non nobles ?
Il ne s’agit pas nécessairement de les requalifier : on peut s’y intéresser de près, leur prêter une oreille critique et tenter de penser leur logique tout en leur vouant un certain mépris. C’est le cas d’Adorno lorsque, dans les pages de Quasi una fantasia qu’il consacre à ce qu’il nomme des « analyses de marchandises musicales »[13], il s’intéresse par exemple à « Especially For You », un tube de 1938 chanté par Bonnie Baker, accompagnée par l’orchestre d’Orrin Tucker. Tout en n’hésitant pas une seconde à qualifier d’« idiotie » cette adresse musicale qui susurre à l’oreille de l’auditeur que la chanson est faite « spécialement pour lui », Adorno en démonte minutieusement le mécanisme pour exposer le renversement fétichiste qui s’y joue : ce n’est pas la chanson qui est faite sur mesure pour l’auditeur, dit-il « c’est lui qui appartient au produit, et non l’inverse ».
Mais c’est vrai que, là où la pensée se contracte, se crispe ainsi pour résister à l’attrait jugé dangereux du tube, elle ne va pas bien loin. Dénoncer, comme le fait Adorno, « l’arnaque » (Schwindel) de cet appel à la singularité de l’auditeur : la belle affaire ! Qui aura jamais cru, littéralement cru à cette interpellation tournée vers l’unique en nous ? Il me semble au contraire que la jouissance ambiguë qu’offre le tube, c’est quelque chose comme la possibilité de cultiver avec amour l’événement chaque fois répété – singulièrement répété – de la perte de l’unique.
Prêter véritablement l’oreille aux tubes implique sans doute de les aimer un peu plus que ne le faisait Adorno dans la posture de résistance crispée qui dictait ses « analyses de marchandises musicales ».
Bonnie Baker, « Especially for you », 1938 – extrait
Album Oh Johnny!, 1958
Vous insistez tout particulièrement sur la charge émotionnelle attachée aux tubes – dimension au cœur de notre réflexion –, et vous écrivez qu’ils viennent « dénicher en nous ce que nous gardons de plus secret : un moment passé, un instant cher, une émotion ou une pulsion inavouable, qui n’appartiennent qu’à nous »[14]. Les spectacles qui convoquent des tubes s’arriment très certainement à cette puissance émotionnelle propre à la musique. Le paradoxe est que l’émotion au départ intime que suscite le tube, qui déclenche un « flot émotionnel nostalgique qui nous emporte vers le passé »[15], devient collective dans sa réutilisation au théâtre ou au cinéma (sur lequel s’adosse votre réflexion). Croyez-vous que ces réutilisations décuplent le pouvoir mémoriel du tube, ou au contraire qu’elles supplantent le souvenir personnel par un souvenir collectif ? Viennent-elles briser l’expérience de la répétition que procure le tube ? Et du même coup, est-ce que ces films et ces spectacles ne viennent pas atténuer la « mélancolie douce amère »[16] attachée aux tubes ?
Aussi personnelle soit l’émotion qu’ils réveillent, parfois de l’ordre de l’inavouable, du refoulé selon vous, les tubes ont la particularité de relever d’un imaginaire commun, ils constituent un « lieu commun »[17], dites-vous, particulièrement hospitalier. Cette double caractéristique du tube permet ce que vous nommez une « télépathie musicale »[18]. Dans les spectacles qui mobilisent les tubes, la musique semble en effet guider les réactions et les émotions du public, être à l’origine de moments d’unisson, qui les rend particulièrement mémorables. Dans la mise en scène de Roland Auzet de Nous, l’Europe, Banquet des peuples, texte de Laurent Gaudé, le tube des Beatles, « Hey Jude », est proposé comme un nouvel hymne pour l’Europe à venir, après plusieurs autres propositions[19]. L’envers de cette puissance d’affect du tube n’est-il pas un court-circuitage de la réflexion ? Une substitution de l’émotion à l’intellect ?
Vous insistez à juste titre, au sujet des spectacles de théâtre qui accueillent ou convoquent des tubes, sur le mouvement qui porte ces chansons, qui les transporte de l’intime vers le communément partagé. Il y a certainement là un transport – dans tous les sens de ce terme, aussi bien spatial qu’affectif – propre à la trajectoire dramaturgique des pièces en question. Mais je dirais aussi que ce transport, de l’intimité à la communauté et retour, c’est au fond l’espace propre (ou proprement impropre) du tube. Peut-être est-ce là ce que Proust désignait, en parlant d’Odette et de Swann, comme « l’air national de leur amour »[20], une expression qui condense ou contient l’impossible cohabitation de ce qu’il y a de plus secret (un amour) et de plus partagé (l’hymne d’un pays).
Ce passage d’À la recherche du temps perdu, auquel je faisais brièvement allusion dans Tubes, est d’ailleurs extraordinaire, si on le lit de près, en tant que phénoménologie du tube. Car la petite « phrase » musicale qui sert ainsi d’hymne amoureux intime est presque une illustration par avance de ce qu’Adorno appellera plus tard le « fétichisme » auditif : Swann renonce explicitement à « se faire jouer […] la sonate entière » à laquelle le motif mélodique appartient et choisit de « ne connaître que ce passage », ce morceau détaché qui prend la place du tout, tel un fétiche qui représenterait métonymiquement l’ensemble duquel il est isolé. Mais surtout, Swann souffre – d’une souffrance qui s’entremêle toujours à la jouissance du tube, qui en fait partie –, il souffre « de songer […] que tandis qu’elle [la petite phrase musicale] s’adressait à eux [Odette et Swann, ses auditeurs privilégiés], elle ne les connaissait pas ». Swann n’est pas loin, ici, de décrire la structure même de l’adresse en forme d’interpellation singulière qui se loge dans l’« Especially For You » que tout tube véhicule implicitement.
Pour dire la force, la puissance hymnique qui est tendue, écartelée entre l’intime et le commun, j’ai proposé le nom d’inthymnité. Elle n’est pas seulement une propriété des tubes qui se révèle à leur écoute, solitaire ou partagée. Elle s’inscrit souvent dans leur forme même, dans leur déploiement dramaturgique interne, comme j’ai tenté de le montrer dans le cas de « Parole, parole ».
Gala, « Freed from desire » – extrait
Album Come Into My Life, 1996
Mais prenons un autre exemple, plus récent : « Freed From Desire », le tube de la chanteuse italienne Gala, un single extrait de l’album Come Into My Life, en 1996. Cette chanson est devenue un véritable hymne sportif dans les stades, comme on a pu l’entendre lors du Mondial de football en 2022. Mais ce qui est frappant, c’est que son devenir-hymne, sa destination hymnique est déjà mise en scène, en quelque sorte, dans la chanson elle-même : « Freed from Desire » parle de son propre effort et essor pour devenir musique pure, sans paroles, de sa propre tension vers un refrain qui n’est composé que d’onomatopées (« Na na na nanna na na, na na na na na »). Avant ce refrain, les paroles disent la libération d’un amour épuré (« my love has got no money, […] no power, […] no fame » : mon amour n’a pas de pouvoir, d’argent ou de célébrité), d’un amour « libéré du désir », donc (« freed from desire »), comme l’énonce le titre en anglais. Or, ce mouvement de libération, il reste parfaitement indéterminé : rien n’indique en vue de quoi se produira l’envolée lyrique du refrain, vers quoi son engouement portera les auditeurs qui participeront au rituel autocélébré du tube chantant son propre élan, son propre emportement ou transport au-delà des mots.
Ce que vous appelez fort justement les « moments d’unisson » à l’écoute – et j’ajouterais qu’il peut s’agir aussi bien d’un unisson dans l’intimité avec soi que d’un unisson avec la foule –, ce sont précisément ces instants où se rejoue de manière exemplaire la singulière puissance du tube en tant qu’inthymne.
Propos recueillis par écrit
en septembre 2023
Notes
[1] Peter Szendy, Tubes. La philosophie dans le jukebox, Paris, Minuit, coll. Paradoxe, 2008.
[2] Mark Twain, « Perce, mon ami, perce ! », dans Les Peterkins et autres contes, trad. François de Gaïl, Paris, Mercure de France, 1910.
[3] Ibid.
[4] Boris Vian, En avant la zizique… et par ici les gros sous, Paris, Le Livre contemporain, 1958.
[5] Peter Szendy, Tubes, op. cit., p. 88.
[6] Ibid., p. 39.
[7] Theodor Reik, The Haunting Melody. Psychoanalytic Experiences in Life and Music, New York, Evergreen Book / Grove Press, 1960.
[8] Mark Twain, « Perce, mon ami, perce ! », op. cit.
[9] Ibid.
[10] Peter Szendy, Tubes, op. cit., p. 11.
[11] Ibid., p. 12.
[12] Voir Corinne François-Denève, « ‘‘Si le roi m’avait donné’’… un tube. Irruption et disruption dans les Misanthrope d’Ivo van Hove et de Jean-François Sivadier », thaêtre [en ligne], Chantier #9 : Tubes en scène ! L’irruption du tube sur les scènes théâtrales contemporaines (coord. Agnès Curel, Corinne François-Denève et Floriane Toussaint), mis en ligne le 15 janvier 2025.
[13] Theodor W. Adorno, Écrits musicaux, II : Quasi una fantasia, trad. Jean-Louis Leleu, Paris, Gallimard, 1982, p. 50.
[14] Peter Szendy, Tubes, op. cit., p. 39.
[15] Ibid., p. 11.
[16] Ibid., p. 91.
[17] Ibid., p. 48.
[18] Ibid., p. 64.
[19]Voir la captation du spectacle sur le site theatre-contemporain.net (le passage s’étend de 2h 18min 30s à 2h 24min 3s).
[20] Marcel Proust, « Du côté de chez Swann », À la recherche du temps perdu, I, Paris, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1954, p. 218.
Pour citer ce document
Peter Szendy, « ‘‘Dans l’inthymnité des tubes’’ », entretien réalisé par Floriane Toussaint, thaêtre [en ligne], Chantier #9 : Tubes en scène ! L’irruption du tube sur les scènes théâtrales contemporaines (coord. Agnès Curel, Corinne François-Denève et Floriane Toussaint), mis en ligne le 15 janvier 2025.
URL : https://www.thaetre.com/2025/01/15/dans-linthymnite-des-tubes/
À télécharger
« Dans l’inthymnité des tubes »
